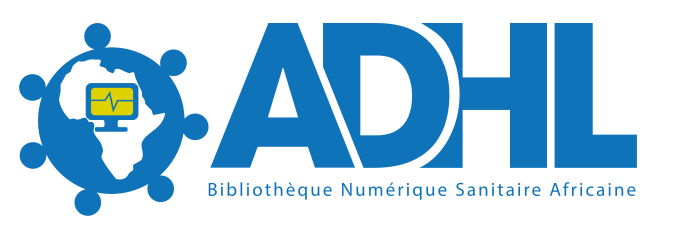Prise en charge des fractures du massif trochantérien au CHME « Le Luxeembourg» : Aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques.
Résumé
Les fractures trochantériennes représentent un problème de santé publique mondial, avec des incidences humaines et économiques énormes. La fréquence de ces fractures ne cesse d’augmenter en raison du vieillissement de la population. Le diagnostic est amélioré par la connaissance des signes cliniques majeurs, mais aussi par la performance des outils radiologiques. L’objectif des méthodes de traitement est d’assurer un lever et la mise en charge précoce pour garantir le meilleur pronostic.
Nous avons mené une étude rétrospective monocentrique descriptive et analytique sur 84 mois allant de Janvier 2017 à Décembre 2023, à propos de 113 cas au service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHME « Le Luxembourg ». Notre objectif était de déterminer les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et d’évaluer les facteurs associés à la mortalité.
Les fractures du massif trochantérien représentaient 67,66% de l’ensemble des fractures du fémur proximal. L’âge moyen des patients était de 66,9±18,6 ans avec des extrêmes allant de 36 et 102 ans. Nous retrouvons une prédominance masculine (54,9%) avec une sex-ratio de 1,4 et la majorité à moins de 60 ans. La chute de sa hauteur était la principale circonstance de survenue soit 66,4%. Le délai moyen d’admission était de 9,2±20,4 jours, dont 63,7% des patients avaient consulté le jour du traumatisme. La hanche droite était touchée dans 53,5% des cas. Plus de la moitié de nos patients avait une très bonne autonomie antérieure à la marche soit 51,3% selon Parker. Des comorbidités étaient notées chez 60,2% de nos patients. L’HTA seule ou associée au diabète étaient les plus observés avec respectivement 31,8% et 25,7%. L’attitude vicieuse en flexion, adduction et rotation externe du membre traumatisé était cliniquement observée chez tous nos patients.
Les patients avaient fait un cliché radiographique de face et de profil de leur hanche traumatisé. Le Clou gamma et la vis plaque DHS étaient les types d’ostéosynthèse les plus utilisés dans notre série avec respectivement 52,2% et 23,9% des cas. La durée d’hospitalisation de nos patients était en moyenne 4,27±0,518 jours avec des extrêmes allant de 3 à 6. Malgré les méthodes thérapeutiques, certains malades ont eu à présenter des complications au cours de leur séjour à l’hôpital ou après leur sortie. Il avait une consolidation dans 98,8%. La nécrose de la tête fémorale a été observée chez 1,8% de nos patients suivis de 0,9% de pseudarthrose. Le démontage du matériel d’ostéosynthèse avait été observé chez 1,8% de nos patients, suivis de 1,8% de recul de la vis cervicale et 0,9% de rupture de matériel.
Le taux de mortalité tournait autour de 24,6%, dont 16,7% des décès survenus au cours des trois premiers mois. Une relation statistiquement significative a pu être déterminée entre l’âge, la présence de tares, l’inactivité et la survenue des complications.
Au dernier recul, le score de Merle d’Aubigné et Postel était excellent et bon dans 81 cas soit 94,2% de nos patients avec une moyenne de 14,87±2,59 et des extrêmes de 5 et 18.