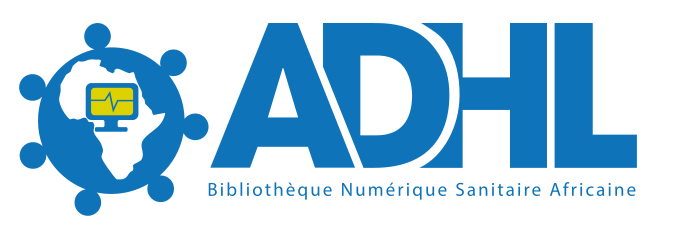Aspect épidémiologique, étiologique et thérapeutique de l’hyponatrémie au CHU de Gabriel Touré Année académique : 2023-2024
Résumé
Introduction : L’hyponatrémie est un trouble hydroélectrolytique fréquent en milieu hospitalier, associé à une augmentation de la morbi-mortalité, de la durée d’hospitalisation, de la perte d’autonomie et des coûts de santé. Son diagnostic et sa prise en charge restent un défi clinique majeur.
Objectif : L’objectif de cette étude a été d’évaluer les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des hyponatrémies chez les patients admis au Service d’Accueil des Urgences (SAU) du Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude transversale descriptive avec collecte prospective des données, réalisée sur une période d’un an, d’août 2023 à août 2024, au SAU du CHU Gabriel Touré à Bamako. Tous les patients hospitalisés au SAU présentant une hyponatrémie confirmée par un ionogramme sanguin ont été inclus. Les données ont été tirées des interviews directs et des dossiers d’hospitalisation et analysées à l’aide du logiciel SPSS version 25.
Résultats : L’âge moyen des patients était de 60,58 ans, avec des extrêmes allant de 15 à 94 ans. La population étudiée était majoritairement masculine, représentant 57,4 % des cas, soit un ratio homme/femme de 1,34. L’altération de la conscience constituait le principal motif d’admission, observée chez 54,3 % des patients. Les antécédents médicaux les plus fréquemment retrouvés étaient l’hypertension artérielle (46,5 %) et le diabète (16,3 %).
Sur le plan clinique, les troubles de la conscience étaient les manifestations les plus fréquentes, touchant 34,9 % des patients, suivis de la déshydratation (20,9 %) et du syndrome oedémateux (14 %). Concernant la sévérité de l’hyponatrémie, la forme légère était prédominante avec 41,9 %, suivie de l’hyponatrémie modérée (29,5 %) et sévère (28,7 %).
Le mode d’installation était aigu (moins de 72 heures) dans 63,6 % des cas. L’hyponatrémie hypovolémique, due à une déplétion hydrosodée, était la plus fréquente et concernait 71,3 % des patients, tandis que les formes hypervolémiques et normovolémiques représentaient respectivement 12,4 % et 16,3 %.
Les pathologies associées les plus courantes étaient l’accident vasculaire cérébral (31,8 %), l’insuffisance rénale (10,9 %), le traumatisme crânien (9,3 %), l’hépatopathie (9,3 %) et l’insuffisance cardiaque (5,4 %). Le déficit sodé était inférieur à 10 g chez 41,1 % des patients.
La correction de l’hyponatrémie a été obtenue en moins de cinq jours chez 51,2 % des patients, tandis que 48,8 % ont nécessité une prise en charge plus longue. L’évolution clinique était favorable dans 73,6 % des cas, mais le taux de mortalité s’élevait à 26,4 %.
Conclusion : L’hyponatrémie est une anomalie électrolytique fréquente, souvent sous-diagnostiquée, avec des conséquences cliniques significatives. Une meilleure compréhension de ses mécanismes physiopathologiques et une prise en charge adaptée, impliquant une approche multidisciplinaire, pourraient améliorer le pronostic des patients et réduire les complications associées.